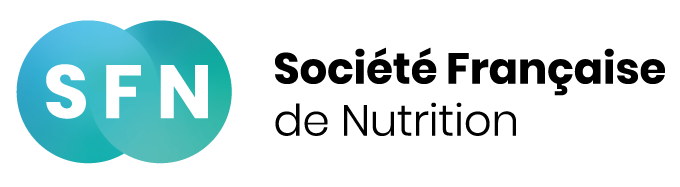D’après les données américaines NHANES, les individus qui cherchent à limiter leurs apports en calories, en sucres, ou en graisses, présentent des scores dépressifs plus élevés, en particulier chez les personnes en surpoids et chez les hommes. Bien que la causalité ne soit pas établie, ces données pointent les pratiques alimentaires restrictives, largement répandues, comme un facteur potentiel à même d’aggraver certains états/symptômes dépressifs… à surveiller en pratique clinique dans l’attente de futures études ?
Le fait de s’imposer des restrictions alimentaires peut-il affecter notre santé mentale ? C’est la question que des chercheurs ont exploré à travers une analyse des données de 28 525 adultes issues des enquêtes nationales américaines NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Plus précisément, les chercheurs ont comparé la présence de symptômes dépressifs1 chez les sujets s’imposant ou non des restrictions caloriques ou des restrictions ciblant certains nutriments (sucres, graisses), en prenant soin d’ajuster leurs analyses sur des facteurs de confusion éventuels (ex. IMC, âge, niveau d’éducation…). Résultats ? Les personnes s’imposant des restrictions caloriques présentaient des scores significativement plus élevés de symptômes dépressifs (+ 0,29 points2 ; IC95% = 0,06 – 0,52). Dans des analyses selon l’IMC, l’association était observée uniquement chez personnes en surpoids s’imposant des restrictions (sur les calories ainsi que sur les sucres ou les graisses), mais pas chez les individus obèses ou en surpoids. Enfin, les chercheurs ont distingué les symptômes dépressifs de type somatique (ex. fatigue, sommeil perturbé) et ceux de type cognitivo-affectifs (tristesse, auto-dépréciation…) : quelle que soit sa nature, un régime restrictif allait alors de pair avec davantage de troubles somatiques chez les hommes ; les restrictions ciblant les sucres ou les graisses s’accompagnaient également de troubles cognitifs/affectifs chez ces derniers.
Ces relations, issues de seules données d’observation, mériteront d’être réévaluées sur d’autres populations, d’autant qu’elles contrastent avec les résultats de certains essais d’intervention, où les régimes restrictifs ont pu réduire les symptômes dépressifs. La différence pourrait être liée au fait que les restrictions que s’imposent les individus en vie réelle sont moins encadrées que dans des essais et peuvent induire des états de stress et/ou perturber le statut nutritionnel.
Source : MennitiG, Meshkat S, Lin Q, Lou W, Reichelt A, Bhat V. Mental health consequences of dietary restriction: increased depressive symptoms in biological men and populations with elevated BMI. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2025;8. https://doi.org/10.1136/bmjnph-2025-001167.
1 Scores obtenus au questionnaire validé PHQ-9 en 9 questions sur des émotions/troubles ressentis au cours des deux semaines précédentes (tristesse, fatigue, manque d’énergie ou d’envies, sommeil perturbé, troubles psycho-moteurs, manque d’appétit, dépréciation, pensées suicidaires…)
2 Sur l’échelle PHQ-9 allant de 0 à 27 points