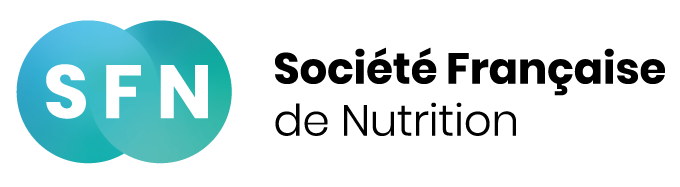Jacques Delarue & Eric Bertin
Le 14 janvier 2025, la revue The Lancet Diabetes & Endocrinology a publié les travaux de la Commission sur la définition et les critères diagnostiques de l’obésité clinique (https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(24)00316-4/abstract).
Cette commission réunie par Francesco Rubino comprenait 56 experts et propose selon ses propres termes :
« … de définir l’obésité clinique comme une maladie chronique caractérisée par un excès d’adiposité retentissant sur le fonctionnement des organes et des tissus. L’objectif spécifique de la Commission était d’établir des critères objectifs pour le diagnostic de la maladie, afin d’aider à la prise de décision clinique et à la hiérarchisation des interventions thérapeutiques et des stratégies de santé publique.
La Commission définit l’obésité comme un état caractérisé par un excès d’adiposité, avec ou sans anomalie de la distribution ou de la fonction du tissu adipeux, et dont les causes sont multifactorielles et encore incomplètement comprises. Elle considère l’obésité clinique comme une maladie systémique chronique compliquée d’atteintes d’organe et/ou d’altérations fonctionnelles. Elle caractérise l’obésité préclinique comme un état d’adiposité excessive avec une fonction préservée des organes et une situation à risque de développer une obésité clinique avec ses diverses complications (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains types de cancer, troubles psychiques…).
La Commission fait plusieurs recommandations :
utiliser l’IMC seul à l’échelle des populations plutôt qu’à l’échelle individuelle. Les arguments sont les suivants :certaines personnes dont l’IMC est égal ou supérieur aux seuils traditionnels pour définir l’obésité ne présentent pas d’excès d’adiposité (par exemple, les athlètes et les personnes dont la masse maigre est supérieure à la moyenne) ; un nombre important de personnes présentant un excès d’adiposité ne montrent pas de signes évidents de maladie ; et bien qu’il existe une relation claire entre l’IMC, l’adiposité et la prévalence des maladies au niveau de la population, l’IMC et la masse grasse ne fournissent aucune information sur l’état de santé d’un individu. La définition actuelle de l’obésité basée sur l’IMC peut soit sous-estimer, soit surestimer à la fois l’adiposité et un état pathologique, pouvant ainsi conduire à un excès de prise en charge avec des conséquences pour le système de santé, notamment le coût.
confirmer l’excès d’adiposité soit par une mesure directe de la masse grasse corporelle, lorsqu’elle est disponible, soit par au moins un critère anthropométrique tel que le tour de taille, le rapport tour de taille/tour de hanche ou le rapport tour de taille/taille en plus de l’IMC, en utilisant des méthodes validées et des seuils adaptés à l’âge, au sexe et à l’origine ethnique. Cependant, en cas d’IMC > 40 kg/m², celui-ci suffit à lui seul.
distinguer l’obésité préclinique de l’obésité clinique, cette dernière ayant au moins un des critères suivants : réduction de la fonction d’un organe ou d’un tissu en raison de l’obésité, réduction des capacités fonctionnelles (mobilité ou autres activités de base de la vie quotidienne).
dispenser en temps utile aux patients ayant une obésité clinique un traitement fondé sur des données probantes, dans le but d’obtenir une amélioration (ou une rémission, si possible) des manifestations cliniques de l’obésité et de prévenir l’aggravation de ses complications.
fournir aux personnes atteintes d’obésité préclinique des conseils sanitaires fondés sur des données probantes, un suivi de leur état de santé au fil du temps et, le cas échéant, une intervention appropriée visant à réduire le risque de développer une obésité clinique et d’autres maladies liées à l’obésité, en fonction de leur niveau de risque individuel.
La commission énonce également que les décideurs politiques et les autorités sanitaires devraient garantir aux personnes souffrant d’obésité clinique un accès adéquat et équitable aux traitements disponibles fondés sur des données probantes. Les préjugés et la stigmatisation liés au poids sont des obstacles majeurs aux efforts de prévention et de traitement efficaces de l’obésité ; les professionnels de la santé et les décideurs politiques devraient recevoir une formation adéquate pour gérer au mieux la problématique majeure pour la santé publique que représente l’obésité.
Commentaires :
Le travail de cette Commission appelle quelques commentaires succincts qui seront plus développés dans un prochain numéro des Cahiers de Nutrition et de Diététique.
S’il est indiscutable que l’IMC n’est pas un très bon marqueur individuel de l’excès d’adiposité, il faut se souvenir qu’il était autrefois appelé indice de Quetelet (un statisticien Belge), non pas pour définir l’obésité mais pour décrire statistiquement une distribution normale au sens statistique de la corpulence, le rapport Poids/Taille2 étant ce qui reflétait le mieux cette distribution normale. Ancel Keys et coll ont plus tard montré que ce rapport rebaptisé IMC (BMI en anglais) était corrélé à la masse grasse, mais le coefficient de corrélation n’était pas optimal, ne permettant ainsi pas de prédire avec précision la masse grasse et donc son excès qui correspond à la vraie définition de l’obésité. Dans les années 50, Jean Vague fut le premier à caractériser des différences de distribution de la masse grasse (en morphotype androïde et gynoïde) et à montrer que le morphotype obtenu influait sur le risque de diabète, d’athérosclérose et de goutte (et même de lithiase biliaire). La quantification de la graisse viscérale intra-abdominale par la mesure de surface obtenue au scanner a permis d’affiner les données de Jean Vague, et divers travaux, dont notamment ceux de l’équipe Québécoise de Desprès et coll, ont confirmé les conséquences délétères de l’excès de graisse viscérale sur le risque cardio-métabolique, et proposé la mesure du tour de taille pour l’évaluer de façon plus aisée en clinique.
Il est connu depuis longtemps aussi que les Asiatiques ont une répartition différente de la masse grasse, de telle sorte que les seuils d’IMC pour estimer un excès d’adiposité ne devraient pas être les mêmes que chez les Caucasiens. Il en est de même pour les seuils du tour de taille.
Il est donc raisonnable de considérer que l’IMC n’est pas le meilleur moyen d’affirmer une obésité. Cependant proposer d’y associer d’autres mesures anthropométriques telles que le tour de taille ou le rapport taille sur hanche pose aussi d’autres problèmes car ils ont leurs propres limites et les seuils d’anormalité restent aussi à définir en fonction des populations. Quant à utiliser des outils de mesure de la composition corporelle comme cela est évoqué par la Commission, cela en pose d’autres : disponibilité des outils, définition des seuils, limitation de la validité notamment de l’impédancemétrie dans les obésités à IMC élevé, même si on exclut les IMC > 40 considérés comme suffisants par la Commission pour affirmer l’obésité.
La commission distingue l’obésité clinique et pré-clinique. On pourrait faire le parallèle avec le « pré-diabète » et le diabète. Mais il est encore plus difficile de savoir quand une personne atteinte d’obésité va développer telle ou telle complication et le risque de cette définition qui exclue d’ailleurs la notion de surpoids est d’entraîner un retard dans le dépistage des complications de l’obésité.
En revanche, insister sur le fait que l’obésité est une maladie chronique est un élément majeur. Il faudra obtenir cette reconnaissance, en particulier en France où les Sociétés Savantes et les Associations de malades se battent pour convaincre les autorités de santé de cette nécessité.
Références :
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(24)00316-4/abstract